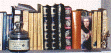
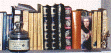
Une fois rentré de la poste, je me suis installé dans le salon d’hiver avec un café et une cigarette pour y achever La loi du plus fort. J’en sors dans une légère brume, et suis extrêmement songeur. Pourtant, c’est assez ordinaire (sans être banal), mais c’est peut-être cet aspect ordinaire qui en fait l’intérêt, et, d’une certaine manière, (voire même) la force. L’auteuresse est occidentale, mais je trouve ce texte extrêmement japonais. Un Japonais (une Japonaise) aurait sans doute pu l’écrire (Shimazaki, par exemple – quoique son écriture soit trop épurée)… C’est publié dans une collection d’un obscur éditeur – Rageot – intitulée « Les maîtres de l’aventure senior ». Plus d’une fois, en lisant, je me suis demandé s’il ne s’agissait pas plutôt d’un texte pour adolescents (et l’illustration de la couverture va dans ce sens – tout comme le sujet et l’intrigue) ; ça n’enlève rien à sa qualité, mais c’est peut-être de là que provient le trouble, d’une espèce de terrain flou et impalpable (impermanent ?) entre une littérature (ou écriture) pour enfants et une littérature pour adultes (mais je pense que beaucoup de textes japonais habitent ce terrain-là). En consultant le catalogue, je n’ai pas été étonné d’y trouver des noms – désormais familiers depuis que je suis bouquiniste (ou vendeur de livres ?) – de la littérature pour enfants et/ou adolescents : Brisou-Pellen, Surget, Noguès, Grenier.
15 janvier 2016