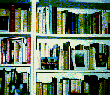
En lisant Lauve, banlieue, métro, je me demande
comment il se fait que je n'ai rien écrit à propos du métro, du train, chaque
jour, à l'époque de Billy, rien à propos de cette épouvantable tranche de la
vie des hommes et de la mienne, en particulier. Sans doute, n'était-ce pas
assez « intéressant », au même titre que le travail ici, que mon travail et ses
conditions si particulières, et pour tout dire, exceptionnelles, et tellement
attachées à ce que je suis, tellement (à bien y réfléchir) prolongement de
moi-même, comme si je l'avais moi-même inventé, comme si, à un moment donné de
ma vie, j'avais pris la décision de la création d'un emploi alimentaire qui soit
à moi seul réservé et qui me soit comme un gant pour de longues années à passer
dans une échancrure de la vie des autres... Mais était-ce bien utile de relater
ce que des millions d'autres humains partageaient avec moi à ce moment-là :
l'attente sur le quai, l'entassement dans les wagons, les rames, la recherche
de la place assise, l'humidité ou la touffeur, les odeurs des autres, le tabac
froid, les vêtements mouillés de pluie, les regards de sommeil, les silences ou
les conversations à tue-tête, l'apathie, la somnolence, la précipitation, la
hâte, les colères rentrées, les songes éveillés, la hideur des visages, des
expressions, des habits, la lumière, parfois, d'un regard, d'un visage,
princesse perdue dans une meute puante, l'indifférence, la rancœur
rentrée, la course à perdre haleine le matin, les vagues hochements de tête aux
habitués du matin ?...