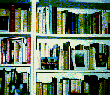
Je me sens mieux. J’ai passé la soirée à traîner
jusqu’à pas d’heure, puis, de peur d’être tenté de fumer une
huitième cigarette, je suis allé me coucher avec un livre, une fois n’est
pas coutume. De nouveau et en vain, j’ai tenté de mettre la main sur Cent
ans de solitude, et, en désespoir de
cause, je me suis rabattu sur Le Foudroyage d’André Stil. Il me
fallait quelque chose de facile. J’avais hésité entre diverses choses
dont Le journal d’une
hôtesse de l’air dont la lecture des premières pages, près des
étagères, m’a laissé perplexe et vaguement embrumé, malgré le recul et le
détachement dont j’avais cru bon de me pourvoir auparavant. Il y avait Le
Foudroyage juste dessous, ce livre qui m’avait intrigué lorsque je
l’avais vu sur un étal de puces, tant pour son titre que pour son auteur
dont le nom avait des accents de familiarité sans que je puisse le localiser
dans ma mémoire. Je ne le peux toujours pas. J’en ai lu au lit les cent
premières pages en attendant le retour d’Éléonore : les mines, 1960,
l’Algérie, une famille dont le père mineur meurt au fond, la parole étant
donnée à chacun des protagonistes, la mère, les deux frères, à la manière d’As
you lay dying, par exemple, chacun s’exprimant donc à sa façon, à
savoir « comme il est » ; cela donne un ton d’authenticité
à l’ensemble (Ramuz, Céline, etc.). C’est pas mal, sans rien de
renversant et je me demande dans quelle mesure je ne m’y attache pas du
simple fait que ce décor, les mines, m’est familier, est celui de son
enfance. Sans doute. Toujours est-il que je ne parviens toujours pas à secouer
la gangue qui tient ce Stil enfermé…
23 octobre 2001