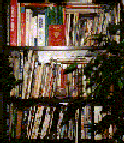
Voici le paragraphe final du texte :
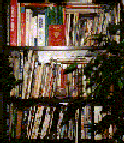
Voici le paragraphe final du texte :
« A quotation from the Bible came to my lips, but I held my tongue, for I knew that clergymen think it a little blasphemous when the laity poach upon their preserves. My Uncle Henry, for twenty-seven years Vicar of Whistable, was on these occasions in the habit of saying that the devil could always quote scripture to his purpose. He remembered the days when you could get thirteen Royal natives for a shilling. » Qu’est-ce que « Royal natives » ? Sans doute influencé par la narration du voyage de l’auteur à Tahiti, où le mot « native » revient souvent, j’ai immédiatement vu un lien entre les deux. Mais qu’est-ce que pouvaient être des « indigènes royaux » ou « de sa Majesté » par exemple ? Cela avait-il un sens ? J’en ai parlé à Éléonore qui ignore ce que c’est, mais pense qu’il peut s’agir d’une marque quelconque, de cigarettes par exemple, et que c’est simplement une manière de signifier un passé très éloigné. De mon côté, je ne peux m’empêcher de voir un lien direct entre le « diable qui cite les Écrits à son avantage » et cette dernière précision qui en serait l’illustration logique. Mais qu’est-ce, en réalité ? Et pourquoi la traductrice (traduction de 1928, et il est curieux que personne n’ait songé à la revoir depuis – mais peut-être est-ce une bonne traduction) a-t-elle ignoré cette phrase ? Pour la simple raison qu’il avait dû être difficile de trouver un correspondant français (ou ignorait-elle de quoi il s’agissait) et comme cette phrase n’apportait rien… Il n’empêche. J’y avais immédiatement vu une allusion à un passé colonial que la traductrice avait préféré passer sous silence. Ai-je raison ? Le réseau me tend les bras… Après vérification : il s’agit d’une sorte d’huîtres élevées dans les eaux britanniques, en général dans des lits artificiels ; Whitstable s’en est fait une spécialité. Bon…
28 novembre 2007