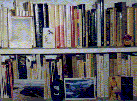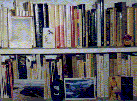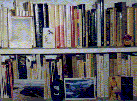
Mon rythme de lecture accuse un net ralentissement. Dans
mon sac, j’ai le Nabe (Le Bonheur)
toujours en cours et
Lauve le pur
de Richard Millet, dont je n'ai jamais entendu parler, que l'on a chaudement
recommandé à Léo, qui m'en a parlé, me l'a prêté. Ma première
réaction lorsque l'on me recommande un auteur ou un livre, c'est la méfiance.
C'est donc méfiant (mais attentif, par voie de conséquence) que je l'ai entamé.
Dès la première page, attrait et agacement se sont mêlés ; attrait parce
que c'est le type d'écriture que je privilégie en tant que lecteur (et parfois
en tant qu'auteur), mais agacement (et c'est là que la méfiance se justifie
– mais en même temps gauchit) car d'emblée ce que je lis, c'est Faulkner
et Simon mariés. Je lis avec intérêt, mais avec sans cesse en tête l'un ou
l'autre, ou l'un et l'autre, sans parvenir à les chasser pour n'attacher mon
attention qu'à Millet que je découvre, que l'on me recommande et qui, jusqu'à
présent, ne me semble être qu'un arrière petit-cousin des deux, pères,
patriarches, que le dernier ne saurait qu'imiter. C'est du moins ma première
impression, et je suis pris entre le plaisir de la lecture d'une écriture qui
me touche et m'attire (et me
ravit) et la conscience irritée d'une histoire (celle de la littérature)
où les auteurs prolifèrent au détriment des écrivains. Et j'hésite à
poursuivre... Léo me dit que l'on dirait du Sébastien, celui du dernier, Légion (rêves et métamorphoses). Je
m'étonne : je ne vois pas le moindre rapport...
22 septembre 2000