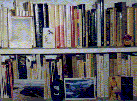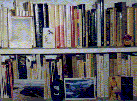
p. 88 :
« Quelle exigence ? Je ne suis le répondant d'aucun
acte, je ne me porte garant de personne, et pourtant je
manquerais à la parole donnée si j'oubliais mon serment :
“ Toujours j'irai de ce côté,
jamais d'un autre. ” » Que pourrais-je ajouter
d'autre ?
Douleur, souffrance,
catastrophe, désastre, abîme, en leitmotiv, tous ces mots qui
appliqués à l'écriture, à l'épreuve de l'écriture, ont
malgré tout, et bien que je comprenne et partage ces mots et les
sensations qui leur sont liées, un curieux goût
d'irréalité, et je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui,
extérieurs à son expérience, à cette expérience de
l'écriture pure, sont confrontés à ces pages. Souffrir
d'écrire, de ne pouvoir écrire, de ne pas savoir quoi écrire,
d'être en butte sans cesse à la question de l'écriture, est
une réelle souffrance. Mais quel degré a-t-elle ? a-t-elle
une vraie réalité ? a-t-elle une réelle
consistance ? n'est-elle pas parfois démesurée,
exagérée, presque indécente, au regard d'autres
souffrances peut-être plus « légitimes », plus
valides (mais si j'écris cela aujourd'hui – et le
pense, quoique cela soit simplement du stade de
l'interrogation –, c'est parce qu'aujourd'hui je suis
calme, parce que je me trouve dans une relative paix, parce que,
dans une certaine mesure, j'ai dépassé cette épreuve-là,
l'épreuve pas tant de l'écriture en soi que de l'écriture
et de la vie, cette épreuve qui m'a tenu des mois durant,
presque des années, et m'a fait vraiment souffrir – ce
que j'ai appelé de l'amour, qui en était et en est encore,
d'une certaine manière. Mais ce n'était pas de l'amour, mais de
l'écriture, rien que de l'écriture. Si cela n'avait pas été
que de l'écriture, je souffrirais en constituant le bulletin à publier, je
souffrirais en relisant tous ces écrits d'amour, je souffrirais
dans les bras d'Éléonore en pleurant en silence un amour perdu.
Alors qu'en définitive, je ne ressens rien...
10 septembre
1997