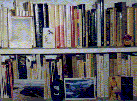
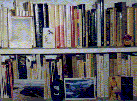
Tout s’est calmé depuis un moment. J’en ai profité pour revenir sur la terrasse où j’ai lu le deuxième récit de Calvino Autobiografia di un spettatore, avec un thé (quelle idée, je n’en avais pas la moindre envie) et ma quatrième cigarette (des sirènes de paquebot me parviennent à l’instant, fortes : comment peuvent-elles parvenir jusqu’ici depuis les Zattere ?). (Je fais à l’instant le lien avec le récit de Calvino qui s’achève par Fellini, dont Amarcord, et je pense à l’apparition du paquebot.) Je me sens un peu mieux… (Alors que je lisais, montait en moi une drôle d’impression, celle que je ne pourrais jamais vivre ici du seul fait que j’y serais toujours un étranger, même si je pratiquais la langue parfaitement et y rencontrais des gens du cru ; je ne pourrais jamais y être à l’aise, et j’ai pensé que l’on ne pouvait jamais être à l’aise dans un pays où l’on ne parle pas sa langue natale ; il doit toujours arriver un moment où l’on se sent déplacé, décalé, pas d’ici ; et je me suis imaginé en Angleterre, dont je parle la langue, et j’ai pensé qu’il en serait certainement de même. Alors, il faudrait continuer à vivre en France en ne considérant Venise que comme un lieu de villégiature…)