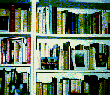
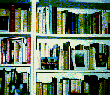
C’était la nuit, je venais d’entamer au salon les dernières pages des annexes au troisième et ultime volume d’Histoire de ma vie, « Le Polémoscope » pour être précis. Le téléphone sonne. C’est la sonnerie de la ligne de la maison. Éléonore est au lit. Ce n’est pas l’un des enfants : ils auraient utilisé l’autre ligne. Qui alors ? Je laisse passer quatre sonneries avant le déclenchement du répondeur ; hésite. Ai-je le temps de gagner la cuisine où se trouve l’appareil le plus proche ? Est-il nécessaire d’aller répondre, et pourquoi à ce moment-là en particulier puisque je ne le fais pratiquement jamais (il faut bien que le répondeur ait son utilité) ? Mais j’y vais. J’aurais pensé à n’importe qui sauf à ma mère. C’est elle, pourtant, qui commence avec un ton de catastrophe, mais très vite bifurque, change de vitesse et de ton et enfile une route qui, je le pressens va être longue. Je suis à la cuisine, ai l’appareil à la main. Je renonce à monter pour me faire épauler par le haut-parleur. Et puis ne me dit-elle pas dès les premiers mots : « Rassure-toi, je serai brève. » ? Je n’ai évidemment pas cru un seul instant qu’elle puisse effectivement appeler brièvement. Mais que faire dans la cuisine avec cet appareil que je suis bien obligé de conserver près de l’oreille ? Je parviens à me faire un café, à me rouler une cigarette, puis à regagner ma place dans le sofa noir du séjour où, le coude droit sur l’accoudoir avec la main qui tient l’appareil à vingt centimètres de mon oreille, je poursuis ma lecture. L’appel a duré une heure quinze. C’est ainsi que j’ai lu « Le Polémoscope » qui, heureusement, n’était pas suffisamment prenant pour que je néglige, de temps à autre, d’imprimer à mon bras un mouvement vers la gauche pour que vienne s’appliquer l’appareil contre mon oreille…