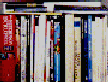
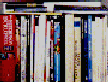
Mais ce trouble se double d’un autre. Alors que je cherche cette dernière page, je m’aperçois qu’en vérité, le texte se poursuit sur la page suivante, 416, il reste encore quelques lignes qui sont véritablement la fin. Je la lis. Ces lignes ne me semblent rien apporter. La véritable fin est celle du bas de la page 415. Il n’empêche : comment se fait-il qu’elle m’ait échappée hier alors que je me revois tenter désespérément de séparer les deux dernières pages (mais je n’ai pas précisé qu’au moment où il me restait trois pages, Éléonore est arrivée pour allumer la télé ; je suis allé dans le jardin d’hiver où l’éclairage est plus que précaire, où j’ai dû me tordre pour parvenir à une certaine lisibilité sous l’abat-jour de la lampe pâle) ? Je note en outre la manière d’épilogue qui débute à la page 412 et où Bergman écrit : « Le jeu pourrait se terminer là, toute fin et tout commencement sont inévitablement arbitraires, puisque je raconte une tranche de vie, et pas une fiction. J’ai pourtant décidé d’ajouter à ça un épilogue entièrement inventé. Il n’existe aucun document concernant la première moitié de l’année 1918. » Il n’empêche que j’ai lu ce qui suit comme si c’était réellement arrivé, de la même manière que j’avais lu la « réalité » des faits précédant comme s’il s’agissait d’une fiction. Bref : tout est vrai. L’intelligence de Bergman, en l’occurrence, constitue en cela : le jeu entre réalité et fiction avec de subtiles et brèves incursions de sa part qui ne font que donner davantage de poids et de force tant à l’un qu’à l’autre. La construction sublime le tout. Quelques notes :